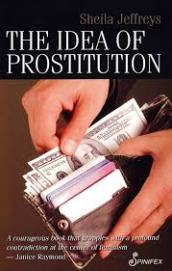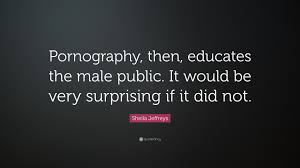Par Sheila Jeffreys

Résumé. L’analyse féministe du transsexualisme — par exemple, celle de Janice Raymond — y voit un phénomène profondément conservateur dans lequel les mutilations chirurgicales servent à maintenir les configurations genrées de la domination masculine et de la soumission féminine. Le transsexualisme prend un virage dans les années 90 et devient le « transgenrisme », utilisé par les théories queer et postmodernes afin de rendre le transsexualisme progressiste.
Le présent texte soutient que le « transgenrisme » est aussi profondément problématique d’un point de vue féministe et que le transsexualisme devrait être vu comme une violation des droits humains.
Il est important que les théoriciennes et activistes lesbiennes puissent analyser de manière critique les choix politiques de l’activisme transgenre (ou « transgenrisme »). Les années 1980 et 1990 ont été témoins de ce qui a été décrit par ses partisans comme un mouvement de libération transgenre[i]. Cela comporte des implications significatives pour les lesbiennes qui ont entrepris des traitements hormonaux ou des filières chirurgicales – peut-être en plus grand nombre qu’avant. Il en va de même pour les féministes lesbiennes à qui on met la pression pour qu’elles acceptent des « lesbiennes » h-vers-f-construites (male-to-constructed-female “lesbians”) dans l’espace et les événements lesbiens. Ça l’est enfin pour une politique féministe lesbienne qui est engagée dans la destruction du genre, plutôt que dans le projet de « s’en amuser ».
Le transgenrisme est un enjeu politique, qui ne devrait pas être relégué à des explications et solutions individualistes comme peuvent en proposer des thérapeutes et des médecins. Je souhaite ici considérer les implications du transgenrisme pour les orientations politiques lesbiennes et gays, selon une approche basée sur les droits humains.
____________________________________________________________________
Note de l’équipe de traduction :
Notre traduction a cherché à rendre les choix sémantiques du texte de Madame Jeffreys, qui, rédigé il y a 23 ans, évite la confusion qu’ont créée des appellations biaisées comme femme trans ou transfemme.
LEXIQUE
Camp : le camp (une forme d’affectation dérisoire et vulgaire)
Drag : travestisme
Experience : vécu
FTM : F-vers-H
Gender dissatisfaction : insatisfaction face à son sexe
Gender : sexe ou genre (selon le contexte)
Male-supremacist : suprémaciste masculin, patriarcal
Male supremacy : suprématie masculine, patriarcat
Male-to-constructed female transsexual : transsexuel h-vers-f-construite
MTF : H-vers-F
Native body : corps natif
Pathologisation : id.
The gender dissatisfied : les personnes insatisfaites de leur sexe
Transgender activist : transactiviste
Transgenderism : transgenrisme, activisme transgenre
Transgenderist : transgenriste
Women-only space : espaces réservés aux femmes ou espace non mixte selon le contexte)
________________________________________________
Dans les années 70, la philosophe féministe des sciences Janice Raymond a livré dans un premier ouvrage The Transsexual Empire (L’empire transsexuel[ii]) une critique rigoureuse de la construction médicale du transsexualisme.
Elle a fait valoir que la chirurgie transsexuelle représentait une manipulation politique des personnes insatisfaites de leur sexe par l’industrie pharmaceutique, le gouvernement étant à la botte de la médecine, comme il a été un temps sous l’emprise de la religion.
Beaucoup de féministes s’attendaient à ce que cette perspective féministe soit adoptée petit à petit, et à ce que le féminisme conduise à l’abandon des stéréotypes de genre et, avec eux, du « besoin » socialement construit d’un transsexualisme. Mais ce n’est pas ce qui s’est produit en fin de compte.
Dans les années 90, le transsexualisme arbore un nouveau visage avec le « transgenrisme », qui utilise les théories et politiques queer et postmoderne pour donner au transsexualisme une allure progressiste. Ces politiques queer/postmodernes exigent l’acceptation du « transgenrisme » comme partie intégrante du mouvement gay et lesbien, les intérêts politiques des lesbiennes et des hommes gays devenant inextricablement liés à la légitimation du transsexualisme.
Je soutiendrai ici que le transsexualisme devrait plus raisonnablement être vu comme une violation des droits humains et ne devrait certainement pas être accepté sans réserve comme une force socialement transformatrice, équivalente au mouvement de libération gay.
LE TRANSGENRISME — QU’APPORTE-T-IL DE NEUF ?
Le transgenrisme se prétend plus progressiste politiquement que le transsexualisme.
En théorie, comme la définit Janice Raymond, la catégorie transgenre « comprend les transsexuels non opérés et opérés, les travestis, les drag queens, le travestisme occasionnel (cross dressers), les gays et lesbiennes, les bisexuel.le.s et les hétéros qui affichent toute tenue ou tout comportement interprété comme “transgressant” les rôles sexuels »[iii]. Certain.e.s théoricien.ne.s du transgenrisme incluent les lesbiennes et les hommes gays dans le phénomène transgenre, au motif que « quiconque ne se sent pas à l’aise avec les rôles sexuels hétéros est un trans (tranny) »[iv]. En réalité, les porte-parole du mouvement tendent à être des transsexuels opérés.
Dans la version vieille école du transsexualisme, des hommes — même si une poignée de femmes étaient aussi impliquées — cherchaient à « changer de sexe » par le biais d’opérations chirurgicales. Ils souhaitaient devenir de « vraies » femmes. Janice Raymond a souligné que le transsexualisme est une construction de la science médicale conçue pour atteindre trois buts. Le premier est simplement le profit découlant d’opérations onéreuses. Un deuxième est un travail d’expérimentation en vue de maîtriser la construction de parties du corps. Le troisième enjeu, politique, est l’inscription dans des catégories sexuelles acceptables des réfractaires au genre, perçu.e.s comme troublant le système à deux genres propre à la suprématie patriarcale.
Le transsexualisme, dans cette analyse, est profondément réactionnaire ; il s’agit d’éviter toute rupture ou élimination des rôles sexuels, comme ce que préconise le projet féministe. Le transsexualisme s’oppose au féminisme en maintenant et renforçant des notions fausses et construites de féminité et de masculinité « correctes ». La grande majorité des transsexuels adhèrent toujours au stéréotype traditionnel de la femme et cherchent à devenir de « vraies » femmes féminines[v]. Leur conservatisme et celui du corps médical à propos de ce qui constitue la féminité est manifeste à la lecture des biographies de transsexuels. On y apprend que les capacités et personnalités des aspirants sont transformées après les opérations et le traitement hormonal. Par exemple, un pilote de course dit avoir découvert qu’il ne pouvait plus conduire aussi bien, une fois devenu « femme ». Un journaliste du Times s’est vu réduit à ne plus pouvoir se soucier que des petites choses de la vie et dit avoir développé une intuition féminine[vi]. Ce qui est perturbant pour les féministes dans ce phénomène est de voir des hommes bâtir un fantasme conservateur de ce que les femmes devraient être. Ils sont en train d’inventer une essence de la féminité qui est profondément insultante et restrictive.
La nouvelle génération de transgenristes a tenu compte d’une partie de cette critique. Iels sont également inspiré.e.s par une analyse postmoderne, qui conteste toute notion de genre fixe ou biologique.
La plupart de ces trans ont été opérés à un moment où ils pensaient toujours qu’ils allaient devenir de « vraies » femmes. Puis, ils ont remis en question cette approche en découvrant des théories politiques plus progressistes à propos du genre ou en réalisant qu’ils n’étaient vraiment pas du tout des « femmes ». Ils ont donc cherché à créer pour eux-mêmes une troisième catégorie, qui leur permettrait de prendre le dessus politiquement en accusant les féministes de conservatisme politique. Le développement du « transgenrisme » pourrait indiquer les façons dont les aspirants transsexuels cherchent à imiter la norme de la féminité à leur époque. À une ère où le féminisme a connu un certain succès en contestant la rigidité des rôles sexuels, la nécessité d’un nouveau modèle s’imposait si le transsexualisme voulait éviter de paraître désespérément rétrograde.
Des théoriciens transgenres comme Kate Bornstein aux États-Unis, une gouine S-M h-vers-f construite, et Jane Langley et Julie Peters, deux « lesbiennes » h-vers-f-construites de Melbourne, ont formulé des arguments quant à une nature nouvelle et progressiste du transgenrisme par rapport au transsexualisme traditionnel, qui aspirait à un stéréotype sexiste de la féminité[vii]. Mais si le transgenrisme est présenté comme particulièrement progressiste, c’est parce que les transgenres ne pensent pas qu’un transsexuel devienne une femme. Ils ne pensent pas qu’une opération soit nécessaire pour qu’une personne devienne transgenre, alors même qu’ils ont eux-mêmes subi ce genre d’opérations. Ils adoptent la théorie postmoderne qui décrète la flexibilité du genre, y voyant une simple construction sociale et se prétendant anti-essentialistes. Dans leur analyse, les transgenristes se présentent comme des missionnaires de l’anti-essentialisme, ayant pour croisade d’apprendre à tous la fluidité du genre.
Ils soutiennent que les transgenres constituent un troisième sexe qui possède les pouvoirs dont jouissaient les chamanes amérindiens˴ne˴s, ont le pouvoir de guérir — particulièrement l’écart de genre entre hommes et femmes — et ont des visions. Mais ce nouveau modèle n’a pas eu beaucoup d’influence sur le transsexualisme traditionnel. Dans un nouvel ouvrage sur les trans de la société australienne, Frank Lewins rejette l’idée que les trans puissent être considérés comme un « troisième sexe ». Ses interviews avec 55 trans h-vers-f nous apprennent qu’« ils ne constituent pas un troisième sexe, mais se conforment aux attentes existantes liées aux femmes féminines »[viii]. Parmi ceux qu’il a interviewés, il n’y avait, écrit-il, « pas de révolutionnaires sexuels. Qu’il s’agisse d’hétérosexuels ou de lesbiennes, ils se voyaient tous comme des femmes[ix]… » Chose intéressante, même les plus « progressistes » des transgenristes, comme Bornstein, tiennent au pronom féminin et sont en colère que certaines féministes leur refusent ce « droit ». Si ces révolutionnaires transgenres tenaient réellement à une perturbation transformatrice des catégories, on pourrait s’attendre à ce que leur préoccupation d’inventer un troisième sexe s’accompagne du désir d’un « troisième » terme, qui ne serait connoté ni mâle ni femelle.
D’un point de vue féministe, on peut se demander si les transgenristes défient réellement les stéréotypes sexuels. Leurs vies et leurs identités entières ont été formées autour d’une adhésion au genre, allant généralement jusqu’à de très graves automutilations. Celles et ceux qui remettent vraiment en question « le genre » sont les femmes et les hommes qui adoptent des analyses féministes et qui rejettent entièrement le genre. Pour être transgenre, vous devez croire qu’il existe quelque chose à « trans-gresser ». Les féministes qui ont rejeté les limites du « genre » ont tendance à une certaine antipathie à l’égard des hommes qui semblent encore obsédés par lui. Les livres écrits par les « transgenristes » sont tout aussi populaires que ceux écrits par les « transsexuels », contrairement aux travaux féministes qui requièrent l’abandon du genre. Les transgenristes trouveraient difficile d’abandonner le genre, car leur projet de vie perdrait alors tout son sens.
Comme le suggère Janice Raymond, les hommes qui sont engagés dans l’éradication des catégories de genre peuvent le faire en se réunissant pour appuyer le féminisme et en cherchant à démanteler la construction sociale de la masculinité. Ils peuvent adopter franchement une orientation politique. Les transgenristes (transgenderists) sont engagés à leur propre « performance » du genre, et non à son élimination. Cependant, ce ne sont pas tous les trans h-vers-f construite qui demeurent attachés au genre. Terri Webb, qui écrit dans un nouveau recueil publié chez Routledge, Blending Genders [Le mélange des genres], est quelqu’un qui a compris l’erreur de considérer son transgenrisme/transsexualisme comme en quelque façon progressiste.
« Beaucoup de transsexuels prétendent être des femmes alors qu’ils sont en réalité des hommes. Tandis qu’il y a quelques années, je ne pouvais parler qu’en mon propre nom en énonçant cette façon de voir, maintenant je me sens capable de parler pour tous les trans h-à-f quand je dis qu’il ne fait aucun doute nous sommes des hommes, bien que des hommes ayant un besoin désespéré d’être des femmes[x]. »
Terri Webb considère que ses dix années d’activisme transgenre furent « une tentative infructueuse d’amener les autres à légitimer mon fantasme ». Son rejet de la pratique et de la politique du transsexualisme est profond.
« J’ai entendu un psychiatre émettre l’opinion que si un homme vient le voir et prétend être Napoléon, il ne va pas tenter de le soigner en l’amputant d’un bras. La question que nous devrions maintenant nous poser est plutôt de savoir si nous avons le droit de prétendre être des femmes, et non pas quels “droits” le reste du monde devrait nous accorder comme complément à notre fantasme[xi]. »
Webb impute son désir à une jalousie basique face aux capacités reproductrices des femmes, combinée à une « expérience de violence homosexuelle sadique dans l’enfance. Je pense que cela m’a conduit à avoir horreur de tout ce qui pouvait s’apparenter à la virilité[xii]. »
Il existe d’autres comptes rendus dans la littérature savante par et sur des transsexuels au sujet de la maltraitance homosexuelle envers des enfants. Le recueil Male Order [L’Ordre viril] à propos de la prostitution masculine de rue à Londres comprend des comptes rendus d’hommes prostitués, incluant des transsexuels, que des agressions masculines ont rendus incapables de se lier aux hommes sur une base de confiance, ou peut-être même de demeurer dans un corps mâle[xiii].
Toute prise de conscience des façons dont les violences ou maltraitances infligées dans l’enfance et dans l’industrie du sexe contribuent au phénomène du transsexualisme, devrait inciter les activistes politiques lesbiens et gays à une certaine prudence avant d’y voir un caractère progressiste.
UNE VIOLATION DES DROITS HUMAINS
Ces dernières années, plusieurs volumes imposants ont été publiés sur les droits des femmes en tant que droits humains[xiv]. Des théoriciennes féministes des droits humains cherchent à inclure dans cette théorie les pratiques masculines de violence à l’égard des femmes. Elles élargissent les schèmes masculins traditionnels des droits humains pour y inclure la violence infligée par des sujets masculins individuels, ainsi que celle de l’État ou de ses agents. Je suggère que la chirurgie transsexuelle et le traitement hormonal devraient être considérés comme une violence acceptée par l’État.
L’on conviendrait probablement aujourd’hui du caractère inacceptable des lobotomies effectuées dans les hôpitaux psychiatriques, il y a encore une cinquantaine d’années, sur les lesbiennes et les gays pour les « soigner ».
La lobotomie serait considérée, du moins par les militant-e-s pour la défense des homosexuel-le-s, comme une intervention chirurgicale politique, approuvée et financée par l’État, pour régler un problème politique. Cela pourrait être comparé à la psychiatrique politique autrefois imposée dans l’Union soviétique.
Je propose que le transsexualisme soit envisagé dans la même optique, comme une forme d’agression médicale, explicitement politique, contre nos droits humains. La mutilation de corps sains et leur soumission à un traitement continu dangereux et potentiellement mortel dérogent aux droits de ces personnes à vivre avec dignité dans le corps dans lequel iels sont né˴e˴s — ce que Janice Raymond appelle leur corps « natif ».
Il y a là une attaque contre le corps menée afin de rectifier une condition politique, insatisfaction face au « genre » dans une société patriarcale basée sur une notion de différence de genre qui est factice et politiquement construite.
Une des intuitions de base du féminisme consiste à reconnaître que le corps des femmes n’est pas le problème. Les féministes ont rejeté et continuent à rejeter la caractérisation par l’appareil médical du corps des femmes comme étant malade et profondément problématique. Les théoriciennes féministes ont démontré les liens entre les médecins du 19ème siècle qui expliquaient les revendications des femmes comme étant de l’« hystérie », résultant de la possession d’un clitoris ou d’un utérus, et les gestes des médecins contemporains qui cherchent à pathologiser la ménopause[xv].
Le mouvement de la santé des femmes a compris que nos corps sont très importants puisque nous les habitons et qu’ils affectent notre vécu. La négation et la pathologisation de nos corps signifient notre négation en tant que femmes. Cette idée est illustrée dans le titre d’un best-seller, le manuel de santé des femmes Nos Corps Nous-Mêmes (Our Bodies, Our Selves) périodiquement réédité depuis sa publication dans les années 70.
Les premiers groupes féministes de sensibilisation avaient pour habitude d’entamer leur réflexion en parlant du corps et des influences destructrices qui poussaient les femmes à trouver leurs corps inadéquats ou impropres, ce qui les poussait à le mutiler. Ces mutilations féminines que les processus de sensibilisation visaient à atténuer comprenaient les régimes, les corsets, les talons hauts ; autant d’attaques silencieuses directes contre le corps pour atteindre un objectif politique, la subordination féminine.
Rhoda Howard offre un moyen utile pour comprendre l’importance de ces automutilations féminines dans un article intitulé Health Costs of Social Degradation and Female Self-Mutilation in North America (Coûts de santé de l’avilissement social et de l’automutilation féminine en Amérique du Nord), paru dans une anthologie consacrée aux droits humains. Elle définit l’avilissement social comme le « traitement de catégories de personnes comme inférieures, méritant moins de respect que les autres ou, en fait, pas de respect du tout »[xvi]. Elle définit la mutilation comme étant « un changement dans la composition du corps ou une façon de décorer/de vêtir son corps qui a des conséquences néfastes sur la santé »[xvii].
Elle explique que l’automutilation féminine comporte trois aspects : « les mutilations que les femmes s’infligent directement, la soumission volontaire aux autres à des fins mutilatrices, et les pratiques de socialisation par lesquelles des femmes plus âgées soit mutilent directement les jeunes filles soit les entraînent à se mutiler elles-mêmes ». Elle suggère que, dans la société nord-américaine, au moment où les femmes ont remporté une certaine libération économique et politique, elles sont devenues « plus fermement assujetties à l’idéologie de leur propre indignité physique[xviii]. » Les femmes « méprisent » leurs propres corps et dépensent énormément de temps, d’énergie et d’argent à tenter de restructurer, purifier ou diminuer leurs corps. Le corps médical est fréquemment l’agent de cette automutilation à travers la chirurgie dite « esthétique »[xix].
Howard utilise le concept de l’automutilation dans un livre sur les droits humains parce qu’elle considère que la subordination culturelle des femmes et d’autres catégories avilies de personnes est systématiquement passée sous silence dans la plupart des débats internationaux actuels sur les droits humains, et particulièrement ceux sur le relativisme culturel et sur les droits collectifs et de groupe.
Elle propose que l’automutilation démontre l’étroitesse et l’inefficacité de s’en tenir aux aspects formels de l’inégalité, comme les opportunités économiques quand l’on cherche à définir l’inégalité des femmes. Les femmes, à l’instar d’autres minorités sociales avilies comme les homosexuel˴le˴s, les Noir˴e˴s et les juif˴ve˴s, vivent « l’infériorisation au quotidien »[xx].
Elle est particulièrement critique envers les théoriciens du communautaire qui critiquent le concept des droits individuels au profit d’une vision holistique, unitaire et égalitaire des groupes ou des communautés.
Le communautarisme d’en haut, pour ainsi dire, qui est souvent préconisé par des élites masculines dont le statut même d’homme signifie un prestige accumulé à mesure qu’ils acquièrent des familles et deviennent chefs de ménage, ne tient pas compte des effets de la communauté sur les personnes situées au bas de l’échelle[xxi].
La philosophie du communautarisme doit prendre en considération « la violence intracommunautaire perpétrée envers certaines catégories sociales au statut avili, incluant les pratiques de socialisation qui amènent les personnes avilies à s’infliger des violences comme l’automutilation ».
Les hommes qui choisissent l’automutilation du transsexualisme proviennent de deux catégories d’êtres avilis : ceux qui se sentent incapables d’aimer les hommes à partir d’un corps d’homme et qui « transitionnent » pour devenir des « hétérosexuels » légitimes, et ceux qui continuent d’aimer les femmes et s’autoproclament « lesbiennes » après l’opération.
Ces derniers ne traînent pas la honte et la perte du statut associées à l’homosexualité, mais ils vivent la honte d’être incapable de préserver le rôle sexuel du mâle dominant. Promu dans les médias gays et hétéros, le statut déprécié de l’homosexualité chez les hommes est démontré par d’autres formes d’automutilation qui sont devenues inextricablement associées à l’identité homosexuelle.
Ces autres variétés d’automutilation incluent les piercings, les tatouages, le marquage au fer rouge et beaucoup de pratiques sadomasochistes.
La récente littérature concernant le transsexualisme au sein de la communauté lesbienne établit des connexions avec la pratique du sadomasochisme. La pratique du SM pour les lesbiennes semble être plus l’apanage des transsexuels que les autres[xxii].
Il est intéressant de constater que les pratiques mutilatrices sont devenues la représentation publique de l’homosexualité au moment précis où les lesbiennes et les hommes gays ont réussi à acquérir une meilleure visibilité et des droits officiels.
Rhoda Howard explique l’attirance accrue des femmes pour l’automutilation comme reflétant une réaction à une plus grande égalité formelle. L’automutilation représente l’effacement de soi.
« L’adoption récente de l’égalité politique et juridique des deux sexes menace l’honneur social des hommes et pousse les femmes à les rassurer en intensifiant leur propre acceptation symbolique de leur statut social avili approprié[xxiii]. »
Cette analyse pourrait être profitablement appliquée aux hommes gays et aux lesbiennes. Il semble qu’une meilleure acceptation par la population puisse être liée au phénomène des automutilations de masse effectuées par ces groupes, au moment précis où l’on pourrait attendre que la fierté politique conduise à une affirmation fière de leur intégrité physique.
Quant aux pratiques « transgenres » qui n’impliquent pas nécessairement des mutilations chirurgicales ou chimiques — le drag, par exemple —, elles pourraient peut-être être considérées comme de la mutilation symbolique ; comme un moyen de saper l’éventuelle menace que constitue l’homosexualité pour la masculinité traditionnelle.
Il est certain que l’enthousiasme pour le drag et toutes les performances transgenres dans les médias populaires — on pense a l’engouement pour le film Priscilla, Reine du Désert — pourrait suggérer que le public hétérosexuel est rassuré par l’automutilation homosexuelle.
La pratique du transsexualisme, comme certaines des autres pratiques automutilatrices auxquelles se livrent des femmes et des hommes, a des conséquences à long terme sur la santé. La prise d’énormes doses d’hormones féminines crée un risque de cancer du sein et d’autres cancers[xxiv]. Les implants mammaires créent de graves dangers pour les hommes (qu’ils posent aussi pour les femmes) de maladies auto-immunes. L’auto-implantation de silicone dans la poitrine, les cuisses et les fesses est réalisée dans certaines parties du monde pour fournir aux hommes hétérosexuels des partenaires sexuels masculins non menaçants.
Dans de tels cas, le transsexualisme peut être vu comme permettant la survivance de l’hétérosexualité machiste. Dans des pays comme la Thaïlande ou le Brésil, l’industrie du sexe alimente le transsexualisme. Des hommes « hétérosexuels » exigent l’accès à des hommes prostitués, mais souhaitent qu’ils ressemblent à des femmes pour pouvoir maintenir une identité hétérosexuelle[xxv]. Ces situations entraînent très souvent des mutilations sévères et potentiellement mortelles.
En réponse aux critiques féministes concernant ces risques sanitaires du transsexualisme, la nouvelle littérature célébrant le transgenrisme constitue une réponse plutôt inadéquate. Dans Lesbians Talk Transgender [Des lesbiennes discutent du transgenrisme], Zachary Nataf soutient que les transsexuel˴le˴s comprennent ces risques et les choisissent avec joie pour accomplir leur transition:
« Dans leur arrogance, les féministes radicales croient mieux connaître ce qui est bon pour les autres personnes. Elles ne semblent pas écouter ou entendre quand les personnes transgenres disent se soigner elles-mêmes et choisir les meilleures options pour réorienter des vies dysfonctionnelles, en acceptent pleinement les risques de santé découlant de la chirurgie (qui est radicale et intrusive) et des hormones (qui accroissent la probabilité de cancer du sein chez les h-vers-f et donnent le cancer aux f-vers-h, entre autres problèmes). Ces risques en valent la peine pour vivre leurs vies comme iels se sentent et comme iels l’ont choisi[xxvi]… »
Néanmoins, le mouvement de santé des femmes n’a généralement pas été infléchi par le fait que certaines femmes défendent des pratiques dangereuses et non nécessaires, comme les taux élevés de césariennes, les implants mammaires, la technologie reproductive et les techniques de contraception. On a toujours compris que c’était la suprématie masculine qui créait le « problème » et les conditions du « choix », et la médecine patriarcale qui fournissait l’illusion d’une solution.
Les conséquences sociales de la chirurgie transsexuelle sont très graves. Dans sa nouvelle introduction (1994) à L’Empire transsexuel, Janice Raymond affirme qu’un des établissements américains les plus prestigieux à réaliser la chirurgie transsexuelle, la Clinique John Hopkins, a abandonné cette pratique après avoir constaté que les résultats pour les personnes ayant subi l’opération n’étaient pas meilleurs que pour celles qui ne l’avaient pas fait[xxvii]. Roberta Perkins, dans son étude auprès de 157 transsexuel˴le˴s à Sydney, a découvert qu’iels souffraient considérablement de chômage, de viols et de coups, ainsi que de la perte d’ami˴e˴s et de leur famille[xxviii]. D’autres études ont démontré que le suicide demeure un danger commun après l’opération comme il l’est avant. Les transsexuel˴le˴s éprouvent de graves difficultés à former des relations sexuelles stables et durables, particulièrement avec les autres hommes[xxix]. Mais il existe très peu d’études de suivi concernant les trans.
LA LÉGITIMATION POSTMODERNE
Les activistes transgenres ont tendance à utiliser la théorie postmoderne pour affirmer la nature progressiste de leur projet. En plus de l’anti-essentialisme de la théorie postmoderne — une idée qui semble avoir été adoptée de façon plutôt inappropriée par les inconditionnels du genre comme semblent l’être les transactivistes — d’autres idées postmodernes, utilisées pour justifier le transgenrisme, suscitent une certaine inquiétude chez les théoriciennes féministes. Certaines des stars les plus respectées de la théorie postmoderne lesbienne et gay présentent les pratiques transgenres comme politiquement progressistes[xxx]. Iels représentent ces pratiques — qui sont généralement des pratiques traditionnelles des hommes gays, vivement critiquées auparavant par les féministes — comme centrales au projet féministe de mettre fin à l’hétéropatriarcat.
En démontrant que le genre est flexible et qu’il n’a pas besoin d’être rattaché à la biologie, les transgenristes donnent l’impression de déstabiliser le système de genre sur lequel est fondée l’organisation du pouvoir mâle. On dit des transgenristes qu’iels « jouent avec » » le genre, pour démontrer que le genre n’est pas à prendre au sérieux et que tout cela peut être juste une source d’amusement et une question de « performance ».
Dans la récente collection britannique Lesbians Talk Transgender [Des lesbiennes discutent du transgenrisme) où sont recensées des citations d’hommes qui se considèrent « lesbiens » et de femmes qui se considèrent comme des hommes hétéro ou gays, Zachary Nataf, une « f-vers-h », écrit, après avoir cité Jean Baudrillard et Judith Butler que « chacun performe son genre comme allant de soi[xxxi]. »
Mais le « genre » ainsi performé a perdu tout le sens politique qu’il comporte dans la théorie féministe. Comme d’autres théoriciens queer/postmodernes qui assimilent le genre à un jeu, Nataf voit le genre comme un moyen utile de créer de l’excitation sexuelle et vestimentaire, une excitation qui continuera d’exister parce qu’elle est amusante.
« Avons-nous besoin du genre ? Pour certain˴e˴s, le genre est un simple outil de l’érotisme, une manière de focaliser les désirs et d’attirer d’autres personnes. Il se pourrait que les genres/sexes fonctionnent plus comme un langage, ou des signaux motivés, mais arbitraires, portent des désirs comme les mots portent du sens, mais en demeurant simplement des signaux ouverts à notre manipulation, et non des réalités essentielles en soi[xxxii]. »
Les critiques féministes lesbiennes ont contesté cette conviction que « jouer avec » le genre est un processus transformateur et soutenu que toute la conception du « genre » qui sous-tend cette approche est gravement déficiente[xxxiii]. La conception postmoderne du genre, qui l’assimile à des ensembles de fringues ou d’attitudes qui peuvent être échangés et combinés à notre guise, ne colle pas bien à la définition féministe matérialiste qui voit la masculinité et la féminité comme les comportements de classe d’oppresseurs et d’opprimées.
Comme l’a indiqué la théoricienne féministe radicale française Christine Delphy, « le genre » n’aura pas sa place quand les femmes seront libres[xxxiv]. Plutôt que de simplement représenter des caractéristiques humaines intemporelles qui doivent être réunies dans l’androgynie et qui ont fait l’objet d’une répartition inéquitable entre les sexes, les caractéristiques de la masculinité et de la féminité sont les comportements de domination masculine et de soumission féminine, et n’auront plus de place quand ce système sera renversé.
Dee Graham a présenté une façon semblable et très utile de comprendre ce qu’on appelle « la féminité ». Dans son magnifique ouvrage, Loving to Survive [Aimer pour survivre], elle caractérise la féminité comme représentative du comportement d’un˴e otage envers son ravisseur, aujourd’hui compris comme faisant partie du Syndrome de Stockholm, une situation où l’otage craint pour sa vie, mais tisse des liens avec le ravisseur, car elle dépend de lui pour sa survie et qu’il fait preuve de bribes de gentillesse. Graham a développé l’idée du Syndrome sociétal de Stockholm pour expliquer l’attachement des femmes aux hommes dans un régime de terrorisme sexuel, qui prend la forme de l’hétérosexualité, de la féminité et du rejet du féminisme par tant de femmes[xxxv].
Le projet postmoderne de « jouer avec » le genre a fourni une défense efficace aux hommes homosexuels qui sont attachés aux pratiques du drag et du camp et qui cherchent à les protéger de la critique féministe.
Selon cette notion de genre comme étant une simple « idée » plutôt qu’une réalité matérielle politique, le public témoin de cette performance (et présumé être l’auditoire « non éclairé » qui croyait le sexe fixé par la biologie), va connaître un éclair de reconnaissance de la flexibilité de genre et réaliser qu’il n’a pas à se conformer aux règles du genre. Cependant, il ne semble pas exister beaucoup de preuves que le public hétérosexuel du drag connaît une telle épiphanie. La masculinité et la féminité ne sont pas simplement adoptées comme résultat d’une fausse conscience. En fait, la célébration rituelle masculine de la féminité dans le drag peut être vue comme insultante par les femmes qui ont subi ses restrictions et pour qui le comportement de subordination est TOUT sauf volontaire. Le « genre » est beaucoup plus qu’une « idée » dans la vie de la plupart des femmes qui ne sont pas en mesure de « jouer avec » ses règles. Leur survie économique et même physique peut dépendre à la fois du fait de revêtir les accoutrements de la féminité et d’exécuter le travail matériel réel qui y est associé, à savoir : le travail ménager, le travail sexuel, le soin des enfants. Quand le « genre » consiste à ressembler à un objet sexuel et réussir tout de même à gérer le travail de la maison — souvent dans des conditions de violence et d’intimidation — l’admiration des hommes gays pour le drag peut s’avérer difficile à comprendre.
L’autre idée que les théoriciennes féministes ont contestée est la tendance de la théorie postmoderne à voir le corps comme une « page blanche » et, d’une façon ou l’autre, pas vraiment réel. Pour les féministes qui basent leurs idées sur la réalité matérielle du corps des femmes et qui voient l’oppression des femmes comme étant bel et bien vécue et connue par le biais du contrôle de leur corps, cette notion ne semble pas adéquate.
Dans une vigoureuse critique de l’adoption par certaines théoriciennes féministes des maîtres à penser postmodernes, Somer Brodribb a fait valoir que les principaux théoriciens postmodernes pourraient être vus comme engagés dans une version inquiétante de la dissociation corps/esprit, cette erreur majeure du suprémacisme masculin que les féministes ont longtemps travaillé à exorciser[xxxvi].
La notion du corps comme étant une « page blanche » semble particulièrement inappropriée au transsexualisme ; pourtant cette façon d’appréhender le transsexualisme se retrouve sous la plume de militants comme Judith Halberstam et de praticiens comme Sandy Stone, une personnalité masculine devenue femme-contruite[xxxvii]. Selon cette analyse, les transsexuel˴le˴s ne font que réinscrire le « texte » de leur corps. Mais le transsexualisme est permanent et brutal dans ses effets sur la santé et le bien-être. Après une chirurgie transsexuelle, une nouvelle « réinscription » ludique cesse d’être possible. La tendance qu’a le post-modernisme à minimiser l’importance du corps l’empêche, en quelque sorte, de réaliser la signification de cette opération pour les transsexuel˴le˴s. Il n’y a rien de « ludique » à cela.
Raymond Thompson décrit ici l’interlude entre deux des opérations complexes qui ont servi à construire son « pénis ». Assemblé à partir de peau et de chair provenant de sa jambe, l’organe fut relié à sa hanche pour un apport sanguin.
« … J’ai encore dû passer six mois à nettoyer le pus coulant de ma plaie ouverte, qui semblait vouloir rester béante pour toujours… Tout ce temps, un long tube flexible pénétrait dans ma hanche, juste en dessous de l’incision, et s’enroulait dans mon abdomen, pour en drainer le sang vicié[xxxviii]. »
Les théoriciennes féministes sont assez raisonnablement préoccupées par le fait que la théorie postmoderne soit inadaptée à ce genre de vécu. Renate Klein a magistralement démontré les insuffisances du champ naissant de la théorie du corps postmoderne « féministe » pour comprendre les façons dont l’oppression influence l’incarnation[xxxix].
LES TRANSSEXUELS PEUVENT-ILS ÊTRE LESBIENNES ?
Dans l’étude menée par Lewins, 47 % des transsexuels h-vers-femmes-construites entretenaient des rapports avec des hommes après l’opération ; « un tiers (31 %) étaient manifestement lesbiens en termes d’orientation sexuelle et environ 1/5 (22 %) étaient asexués[xl]. » Les transsexuels m-à-f construites qui ont toujours entretenu un rapport sexuel aux femmes et qui continuent de le faire après leur opération transsexuelle se redéfinissent eux-mêmes comme « lesbiennes. » Du fait de cette redéfinition, il y en a qui réclament l’accès aux espaces et événements réservés aux femmes et aux lesbiennes.
L’engagement féministe à créer des espaces non mixtes est basé sur une définition de « femme » comme catégorie politique créée par l’oppression. L’identité « femme » résulte de l’expérience de vivre en tant que femme sous un régime patriarcal. Cela inclut l’expérience de vivre dans et en tant que corps femelle et la façon dont les réalités ou potentialités de ce corps (menstruations, maternité) sont construites dans la société patriarcale. Cela signifie l’expérience de toute une vie sur les façons dont les politiques du langage corporel et de l’espace diminuent et restreignent la liberté des femmes. Les espaces et événements non mixtes ont été créés pour accorder aux femmes une liberté face aux contraintes de l’oppression des femmes, un espace où une vision différente pourrait être créée et des possibilités différentes, réalisées. Une personne élevée comme un homme et dans le corps d’un homme qui acquiert l’idée qu’il possède en lui l’essence de la féminité ou du sexe féminin est vue par beaucoup de théoriciennes féministes comme souffrant d’un fantasme précisément issu des notions patriarcales de ce qu’une femme devrait être, celles-là mêmes auxquelles les féministes cherchent à échapper. Le désir qu’a cet homme d’accéder aux espaces réservés aux femmes est probablement très différent de celui qu’éprouvent les féministes. Il souhaite entrer dans les espaces non mixtes pour pouvoir être accepté comme une « vraie » femme, tandis que les féministes recherchent de tels espaces pour pouvoir radicalement déconstruire et recréer ce que le mot « femme » pourrait signifier au-delà des définitions créées par des hommes. Il y a des transgenristes qui n’appuient pas cet entrisme. Kate Bornstein, en particulier, dit que les femmes devraient avoir droit à leurs propres espaces[xli]. Mais cette exigence d’entrisme a créé de sérieux désaccords politiques entre femmes et des scissions dans beaucoup de groupes féministes lorsque certaines ont défendu la cause des transsexuels et que d’autres s’y sont opposées.
Les féministes lesbiennes ont d’autant plus de mal à accepter que les « lesbiennes » chirurgicalement construites devraient prendre part aux activités réservées aux lesbiennes et pénétrer les espaces exclusivement réservés aux lesbiennes. Ce sont les féministes lesbiennes qui ont revalorisé le terme « lesbienne », faisant d’un terme lourd de mépris un emblème de fierté, à tel point que c’est maintenant un terme acceptable pour beaucoup de femmes qui ne se diraient jamais féministes. Les féministes lesbiennes qui se sont réapproprié ce terme lui donnaient un sens particulier ; celui d’une rébellion contre la suprématie masculine. La lesbienne a été définie dans la théorie féministe lesbienne comme « la colère de toutes les femmes condensée jusqu’au point de rébellion » ou comme « un acte de résistance »[xlii]. Le lesbianisme a été perçu comme une détermination fière à aimer et valoriser, contre toutes attentes, les femmes, ces citoyennes de seconde classe aux yeux du patriarcat. Les lesbiennes ont subi la haine et les sévices que le patriarcat réserve à celles qui sont perçues comme transgressant le rôle subordonné des femmes. Les lesbiennes ont été fières de s’identifier comme « présomptueuses ». Les espaces réservés aux femmes ou aux lesbiennes que les féministes lesbiennes ont créés depuis la fin des années 60 et le début des années 70 étaient des endroits et des organisations où l’on pouvait construire une culture fière et résistante de rébellion et d’amour des femmes.
Le transsexuel h-vers-f-construite qui s’autoproclame « lesbienne » donne à ce mot une signification très différente. Il n’a ni changé son orientation sexuelle ni acquis une orientation rebelle. Son amour des femmes était socialement approuvé avant son opération et il aimait les femmes d’un point de vue d’homme, qui est membre de la classe dominante. Il n’a pas surmonté la haine de la société envers les lesbiennes et les femmes afin de pouvoir aimer un être comme lui-même. Il demeure « hétérosexuel », mais a changé son corps et ressent le besoin de changer son étiquette a cet effet. Il n’a pas aimé les femmes à partir du vécu d’une femme. Terri Webb, le transactiviste h-vers-f qui a rejeté la pratique et la politique du transsexualisme et qui s’identifie comme homme, est aussi suffisamment honnête pour s’identifier comme « gay », car il éprouve un lien sexuel aux hommes[xliii]. Ce serait faire preuve d’un certain respect pour la communauté lesbienne si les trans h-vers-f qui souhaitent avoir des rapports sexuels avec des femmes étaient suffisamment honnêtes pour s’identifier comme « hétérosexuels » », mais il semble y exister peu d’enthousiasme pour cette voie.
Bien des lesbiennes éprouvent beaucoup de sympathie pour les « lesbiennes » construites, reconnaissant que ce sont des hommes très malheureux, qui font face à de graves difficultés personnelles et politiques, mais leur lutte est différente de celle des lesbiennes.
POURQUOI DES LESBIENNES CHANGENT-ELLES DE SEXE ?
Les transsexuelles f-vers-h ont toujours été considérablement moins nombreuses que les h-vers-f. Dans la récente étude menée par Frank Lewins en Australie, le nombre restreint de répondantes f-vers-h, soit 5 sur 60, l’a amené à écrire qu’il ne pouvait rien conclure sur ce que le transsexualisme signifiait pour les femmes qui y aspirent[xliv]. La question des lesbiennes qui transitionnent pour devenir des hommes — hétéros ou gays — n’a pas bénéficié de beaucoup d’attention dans la théorie et la politique lesbiennes. Les trans f-vers-h n’ont pas exigé d’accès à l’espace lesbien ou à l’attention des lesbiennes de la façon dont l’ont fait les « lesbiennes » h-vers-f. Les féministes, qui avaient tenu pour acquis que leur politique visait un démantèlement de l’idée même de ce que signifie être un « homme » plutôt qu’une transformation en hommes, n’ont pas vu le transsexualisme survenant au sein de la communauté lesbienne comme étant un enjeu pour elles. Mais il est désormais impératif pour les communautés lesbiennes d’y prêter attention. Ces dernières années, certaines pratiques transgenristes, de la prise d’hormones mâles (testostérone) à des interventions chirurgicales complètes, ont été mises à la mode par la théorie queer, les magazines féminins et le quotidien (libéral) The Guardian. Le spectacle de lesbiennes dépeintes comme des « monstres » qui veulent au fond être des hommes a ressurgi avec une vigueur renouvelée des fadaises sexologiques des années 1950 pour hanter les magazines féminins populaires et la littérature lesbienne d’aujourd’hui. Comme l’identité dite « transsexuelle » semble être apprise par le biais de ces sources, on peut donc s’attendre à une prolifération de ces pratiques très dommageables parmi les lesbiennes.
Jusqu’à récemment, la littérature sur le transsexualisme f-vers-h suggérait que les demandeuses d’opérations chirurgicales éprouvaient toutes du désir pour des femmes auparavant et ne se sentaient pas en mesure de le faire dans le corps d’une femme[xlv].
Plutôt que de vouloir être des « hommes », elles voulaient éliminer les parties de leur corps qui leur rappelaient qu’elles étaient des femmes. Comme le glisse Mark Rees dans la nouvelle anthologie de Routledge, Blending Gender [Le mélange du genre], « Évidemment, je méprise mon corps féminin[xlvi]. » Plutôt qu’une envie de virilité, leurs aspirations reflétaient une haine du féminin (peu surprenante dans une culture qui hait les femmes). Pour les femmes, le transsexualisme a résulté de leur oppression en tant que femmes et en tant que lesbiennes.
Mais on observe depuis peu un nouveau phénomène, qui n’est peut-être pas statistiquement important, mais demeure très préoccupant. Certaines lesbiennes, et cette tendance semble particulièrement affecter celles qui ont baigné dans l’industrie du sexe, cherchent à se faire opérer pour devenir des hommes « gays »[xlvii].
L’anthologie Lesbians Talk Transgender [Des lesbiennes discutent du transgenrisme] illustre le nouvel enthousiasme queer/postmoderne/tendance pour les mutilations transsexuelles chez les lesbiennes. Zachary Nataf, qui a dans cet ouvrage assemblé les témoignages de « lesbiennes » trans f-vers-h et h-vers-f, écrit « avoir vécu comme une lesbienne “butch” pendant 20 ans, une stratégie très efficace pour composer avec ma dysphorie de genre avant d’arriver à croire que je pouvais vivre en tant que personne transgenre sans chuter de la mappemonde sociale de ce qui était autorisé à vivre » »[xlviii].
Ce commentaire pourrait être interprété pour signifier que l’aspect nouvellement à la mode du transsexualisme, ainsi que son acceptation politique dans la théorie postmoderne/queer ou s’inscrivent les propos de Nataf, l’ont inspirée à se faire opérer, alors qu’auparavant, elle aurait pu continuer à vivre en tant que lesbienne. Elle s’attend à ce qu’une publicité accrue sur les joies du transsexualisme encourage d’autres personnes à se prêter à des opérations, puisqu’elle-même n’a pas été empêchée par le manque de modèles sociaux (role models) : « Ce qui m’a manqué pendant toutes ces années était de voir des représentations de personnes transgenres, surtout des f-vers-h, et d’entendre leurs récits[xlix]. »
Le désir qu’ont certaines lesbiennes d’échapper à leur corps féminin prend ces jours-ci la tournure d’un culte d’automutilation chimique par la prise de testostérone. L’édition de juillet/août 1995 du magazine australien HQ contient un article intitulé When Girls Will Be Boys [Quand les filles seront des gars] (variante du proverbe fataliste « Boys will be boys ») qui présente de jeunes lesbiennes américaines, encore ici associées à l’industrie du sexe, qui s’injectent mutuellement de larges doses de testostérone[l]. Le médecin qui leur fournit le médicament admet que ses risques pour la santé sont inconnus et qu’il est potentiellement dangereux, mais il le leur donne tout de même, car il voit ces lesbiennes comme une minorité opprimée de femmes transgenres qui se le procureraient elles-mêmes de toute façon. Parmi les lesbiennes, les pratiques de recours à des hormones chimiques (ainsi qu’à de véritables opérations) s’inscrivent parmi une prolifération d’automutilations promues depuis une dizaine d’années. Le sadomasochisme, les piercings et tatouages, ainsi que d’autres formes d’automutilation qui ne sont généralement pas vues comme « volontaires », telles le tailladement des poignets et des formes « non récréatives » d’automutilation, semblent avoir précédé l’automutilation chimique et chirurgicale.
Comme elles souffrent d’oppression à titre de femmes et de lesbiennes, on peut s’attendre à ce que les lesbiennes se livrent à des pratiques d’automutilation, tout comme d’autres cohortes de personnes opprimées. Ce qui est intéressant dans le cas des lesbiennes, c’est qu’alors que certaines ont évité les formes plus traditionnelles d’automutilation « féminine » comme les talons hauts ou les abdominoplasties, d’autres ont inventé des formes d’automutilation plus spécifiques aux lesbiennes.
Dans les ouvrages traitant des violences sexuelles infligées aux enfants, l’automutilation est décrite comme une conséquence assez courante de ces sévices[li]. Par ailleurs, il semble de plus en plus que les violences infligées par les hommes aux femmes dans l’industrie du sexe entraînent des résultats similaires.
LA POLITIQUE QUEER
Contrairement à la libération gay ou au féminisme lesbien, la politique queer inclut spécifiquement les adeptes des pratiques transgenres ainsi que d’autres formes censément « volontaires » d’automutilation, comme le sadomasochisme. L’acceptation et la célébration du transgenrisme dans cette politique entravent particulièrement toute analyse critique.
Les événements « ’queer » sont communément annoncés comme adressés aux lesbiennes, aux hommes gays, aux bisexuel.le.s et aux transgenres. En juillet 1995 s’est tenue à Melbourne une conférence intitulée Have Your Say [Exprimez-vous] au sujet de la jeunesse et de la sexualité. Une des organisatrices est venue me demander d’y prendre la parole. J’ai été surprise et heureuse parce que la conférence semblait avoir une perspective « ’queer » (en s’adressant à la jeunesse lesbienne, gay, bisexuel˴le et transgenre) et que les politiques « ’queer » sont rarement très réceptives au féminisme lesbien radical. J’ai dit que oui, je serais heureuse d’y prendre la parole, mais que j’allais devoir inclure quelque chose à propos du transsexualisme comme étant une violation des droits humains puisqu’il en relevait de ma responsabilité envers n’importe quelle jeune lesbienne ou garçon homosexuel présent qui pouvait envisager le transsexualisme. Elle m’a immédiatement répondu que je ne pourrais dès lors pas m’exprimer, puisqu’aucune critique politique du transgenrisme n’était autorisée. L’analyse critique était perçue comme peu soutenante à l’égard des « transgenres » qui pourraient être présents et cette conférence se voulait très « soutenante ». Toute prise de position contre la construction médicale et politique du transsexualisme est aujourd’hui perçue comme ringarde, puritaine et une forme de censure.
QUE FAIRE ?
J’ai fait valoir que le transsexualisme est dangereux pour la santé et la survie sociale de celles et ceux sur qui il est pratiqué et qu’il pourrait être considéré comme un affront aux droits humains. Il est également dangereux au plan politique pour les possibilités de liberté des femmes, puisqu’il maintient l’idée d’une dichotomie de genre, la base même de la suprématie masculine. Comme le transsexualisme est socialement construit, il est important d’envisager des façons de contrer la promotion de cette pratique. Frank Lewins souligne que c’est la publicité faite au transsexualisme qui permet à des hommes de développer cette « identité ».
« Bien qu’un tiers des transsexuelles étaient convaincues de leur identité comme femme avant d’en venir à se voir comme “transsexuelle”, la moitié du groupe s’est découvert une identité transsexuelle au moment précis — ou juste après – leur premier accès à de l’information sur le transsexualisme, qui s’est produit en moyenne vers l’âge de 18 ans[lii]. »
La profession médicale n’a pas besoin d’orienter vers des interventions chirurgicales les personnes insatisfaites de leur sexe. Le counseling [mise en discussion cadrée] est une option permettant d’encourager la clientèle à adopter une lecture plus politique de leur situation et à réaliser qu’iels peuvent se rebeller contre les contraintes d’un rôle prescrit de genre, et se s’identifier à leur propre sexe dans leur corps « natif ». Malheureusement, beaucoup de médecins sont si convaincus de l’existence d’un phénomène qu’iels définissent comme le transsexualisme, qu’iels n’offrent pas d’autre approche que l’automutilation.
La transsexuelle Raymond Williams décrit sa première visite à la clinique d’identité de genre de l’hôpital Charing Cross de Londres. Quand le médecin lui a demandé quels étaient ses plus lointains souvenirs, elle a répondu qu’elle savait dès l’âge de cinq ans qu’elle était un garçon. Cela a immédiatement convaincu le médecin que Raymond était une transsexuelle réelle et biologique, méritoire d’une intervention chirurgicale.
Cela semblait important, et il a dit que je pouvais penser qu’il s’agissait de mes tout premiers souvenirs, mais qu’en réalité j’avais toujours été comme ça, même entre zéro et 5 ans[liii].
Le médecin a donc mis en toute confiance cette fille de seize ans sous hormones en lui disant qu’elle devrait attendre l’âge de 21 ans pour l’opération. En fait, celle-ci n’a pas attendu jusque là pour subir une hystérectomie et une double mastectomie. Le docteur D.H. Montgomery, qui signe l’épilogue du récit de Raymond Thompson, explique qu’il existe deux types de transsexualisme ; le primaire ou « fondamental » et le secondaire. Il considère que 80 % des trans f-vers-h sont de type primaire et que ces proportions sont inversées chez les trans h-vers-f. Même en l’absence du moindre élément probant pour étayer sa conviction, il semble convaincu que les trans primaires sont biologiquement construits par une hypothétique montée subite d’hormones inappropriées qui survient au stade utérin et masculinise ou féminise le cerveau du fœtus.
Si une solution (hormis l’automutilation) doit devenir accessible aux personnes insatisfaites de leur sexe, alors il est important d’interrompre la promotion énergique de solutions chimiques et chirurgicales, par le corps médical, les médias de masse et la politique queer tendance, même auprès des plus jeunes enfants.
Janice Raymond ne pense pas que la législation interdisant les opérations soit la voie à suivre. Je n’en suis pas si certaine, et le fait de classifier le transsexualisme comme une violation des droits humains serait un pas dans la bonne direction pour rendre illégales de telles opérations.
Terri Webb, le militant h-vers-f pour les droits des trans qui considère désormais ses actions comme erronées, demande si les trans qui sont parvenu˴e˴s à des conclusions similaires ne devraient pas « faire campagne pour mettre fin aux interventions hormonales et aux chirurgies de changement de sexe »[liv] ? Si même certain˴e˴s transsexuel˴le˴s se posent maintenant cette question, il semble raisonnable qu’elle figure au programme des féministes lesbiennes. Des théoriciennes féministes des droits humains ont suggéré que l’État puisse être tenu responsable de pratiques violentes à l’égard des femmes du fait de son acceptation ou promotion de ces pratiques. Le soutien de l’État pour l’agonie que constitue le transsexualisme — par le financement des opérations, par exemple, et l’acceptation de la promotion de solutions chimiques ou chirurgicales dans ses hôpitaux — pourrait être contré par une reconnaissance du transsexualisme comme une forme de violence envers la personne concernée et, par conséquent, comme une violation des droits humains.
Il semble bel et bien que le transsexualisme grandit en importance comme forme de destruction violente des corps lesbiens, encouragée non seulement par l’industrie pharmaceutique, mais aussi par le queer, la théorie postmoderne et l’exploitation des lesbiennes comme bizarrerie par la culture populaire.
Il est temps d’amorcer une discussion sérieuse à propos de ce que devrait être la réponse politique des activistes et théoriciennes lesbiennes à cette forme ancienne, mais revigorée d’oppression des lesbiennes.
NOTES
[i] Nataf, Zachary. (1996) Lesbians Talk Transgender. Londres : Scarlet Press, pp. 26-29.
[ii] Raymond, Janice G. (1994) L’Empire transsexuel. Paris, Seuil, 1981.
[iii] Ibid.
[iv] Peters, Julie et Jane Langley. (1994) ‘The Transgendered in the Queer Community : Gender Reactionaries or Transcenders?’ Article livré à la Melbourne InterUniversity Gay and Lesbian Studies Seminar Series, 1er décembre 1994, p.6.
[v] Lewins, Frank. (1995) Transsexualism in Society. A Sociology of Male-to-Female Transsexuals. MacMillan Education: South Melbourne, Australie, p. 135.
[vi] Jeffreys, Sheila. (1990) Anticlimax: A Feminist Perspective on the Sexual Revolution. The Women’s Press: Londres. Chap. 4.
[vii] Bornstein, Kate (1994) Gender Outlaw. Londres. Routledge, p. 190.
[viii] Lewins, op. Cit., p. 133,
[ix] Ibid,, p. 135.
[x] Webb, Terri. (1996) Autobiographcal Fragments from a Transsexual Activist. In Ekins, Richard et Dave King (dir.) Blending Genders. Social Aspects of Cross-Dressing and Sex-changing. Londres : Routledge, p. 190.
[xi] Ibid., p. 192.
[xii] Ibid., p. 191.
[xiii] Gibson, Barbara. (1995) Male Order: Life Stories frm Boys Who Sell Sex. Londres : Cassell.
[xiv] Cook, Rebecca J. (dir.) (1994) Human Rights of Women. National and International Perspectives. Philadelphie : University of Pennsylvania Press. Peters, Julie et Andrea Wolper (dir.) (1995) Women’s Rights – Human Rights. International Feminist Perspectives. NY: Routledge.
[xv] Coney, Sandra. (1004) The Menopause Industry. Melbourne: Spinifex.
[xvi] Howard, Rhoda. (1993) “Health Costs of Social Degradation and Female Self-Mutilation in North America,” in Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney (dir,) Human Rights in the Twent-First Century: A Global Challenge. Dordrecht (Pays-Bas): Martinus Nijhoff, p. 503.
[xvii] Ibid., p. 506.
[xviii] Ibid., p. 508.
[xix] Sur la chirurgie esthétique, voir Davis, Kathy. (1995) Reshaping the Female Body. New York: Routledge.
[xx] Howard, op. cit, p. 514.
[xxi] Ibid., p. 515.
[xxii] Nataf 1996, op.cit,
[xxiii] Howard op.cit,, p. 513. Une explication semblable pour les troubles alimentaires chez les femmes est sonnée dans Wolf, Naomi (1991) Quand LA beauté fait mal, Paris : First.
[xxiv] Raymond op.. cit. p.33.
[xxv] Voir Gibson 1995 op.. cit.
[xxvi] Nataf op.. cit. p. 43.
[xxvii] Voir Calkin, Jeremy (1994) The Third Sex. The Age. 10 septembre. Réimprimé de The Independent on Sunday.
[xxviii] Raymond op.. cit. p. xii.
[xxix] Lewins op.. cit. p. 137.
[xxx] Voir, par exemple : Butler, Judith. (1993) »Critically Queer.’ GLQ, 1:1, 17-23.
[xxxi] Nataf, op.cit., p. 57
[xxxii]Ibid., p. 56.
[xxxiii] Voir Jeffreys, Sheila. (1994) “The Queer Disappearance of Lesbians”, Women’s Studies International Forum, Vol. 17, no 5, pp. 459-472, et Jacquelyn N. Zita. « Gay and Lesbian Studies: Yet Another Unhappy Marriage?” in Linda Garber (dir.) Tilting the Tower. Lesbians Teaching Queer Subjects. New York: Routledge.
[xxxiv] Delphy, Christine (1993) Rethinking Sex and Gender. Women’s Studies International Forum, 16::1, pp. 1-9.
[xxxv] Graham, D.L.R. avec E. Rawlings et R. Rigsby (1994) Loving to Survive : Sexual Terror, Men’s Violence, and Women’s Lives. NY: NYU Press.
[xxxvi] Brodribb, Somer. (1992) Nothing Mat(t)ers: A Feminist Critique of Post-Modernism. Melbourne, Australie : Spinifex.
[xxxvii] Halberstam, Judith. (1994) “F2M: The Making of Female Masculinity’dans Doan, Laura (dir.)The Lesbian Postmodern, New York: Columbia University Press.
[xxxviii] Thompson, Raymond, avec Sewell, Kitty (1995) What Took You So Long: A Girl’s Journey to Manhood. Londres : Penguin. P. 290.
[xxxix] Klein, Renate (1996). (Dead) Bodies Floating in Cyberspace: Post-modernism and the Dismemberment of Women. Dans Diane Bell et Renate Klein. Radically Speaking. Feminism Reclaimed. Melbourne: Spinifex
[xl] Lewins, op.cit., p.95.
[xli] Bornstein 1994, op.cit.
[xlii] Radicalesians. (1973) « The Woman-Identified-Woman, » dans Phil Brown (dir.), Radicl Pschology, Londres : Tavistock Publications, et Clarke, Cheryl (1981) “Lesbianism: An Act of Resistance’ dans Morales et Anzualda (dir.). This Bridge Called My Back. Watertown, MA: Persephone Press.
[xliii] Webb, Terri op.cit.
[xliv] Lewins op.cit.
[xlv] Voir Lothstein, Leslie Martin. (1983) Female-to-Male Transsexualism. Boston : Routledge and Kegan Paul.
[xlvi] Rees, Mark. Becoming a Man : The Personal Account of a Female-to-Male Transsexual. Dans Ekins, Richard et Dave King (dir.). Blending Genders. Londres : Routledge 1996, p. 33.
[xlvii] Voir Rubin, Gayle. (1992) “Of Catamites and Kings: Reflections on Butch, Gender, and Boundaries”, dans Joan Nestle (dir.) The Persistent Desire. Boston : Alyson et Halberstam op.cit.
[xlviii] Nataf 1996 op.cit. Déclaration de l’auteur.
[xlix].Ibid.
[l] ”When Girls Will Be Boys”. (1995) HQ juillet/août.
[li] Voir, par exemple : Courtois, Christine A. (1988) Healing the Incest Wound : Adult Survivors in Therapy. New York: W.W. Norton.
[lii] Lewins op.cit. p. 75.
[liii] Thompson op.cit. p. 99.
[liv] Webb, Terri op.cit.p. 194.
_________________________________________________________________
Sheila Jeffreys a été professeure senior en Science politique à l’université de Melbourne où elle a enseigné et écrit dans les domaines de la politique de la sexualité et de la politique lesbienne et gay jusqu’en 2015. En plus d’innombrables articles et chapitres d’anthologies, elle a publié plusieurs livres sur l’histoire et la politique de la sexualité : The Spinster and her enemies: feminism and sexuality (1985), The Sexuality debates (1987), Anticlimax: a feminist perspective on the sexual revolution (1990), The Lesbian heresy: a feminist perspective on the lesbian sexual revolution (1993), Unpacking queer politics: a lesbian feminist perspective (2003), Beauty and misogyny: harmful cultural practices in the West (2005), The Idea of prostitution (2008), The Industrial vagina: the political economy of the global sex trade (2009), Man’s dominion: religion and the eclipse of women’s rights in world politics (2012), Gender hurts: a feminist analysis of the politics of transgenderism (2014) et The Lesbian revolution: lesbian feminism in the UK 1970–1990 (2018).
_______________________________________________________
Traduit par Sarah Vercamst pour TRADFEM
Version originale: « Transgender Activism: A Lesbian Feminist Perspective ». Journal of Lesbian Studies, Vol. 1, Nos 3-4, 1997.
Tous droits réservés à Mme Sheila Jeffreys, dont on trouvera d’autres textes sur son site: http://www.sheilajeffreys.com et que Francine Sporenda a récemment traduite sur son site: https://sporenda.wordpress.com/